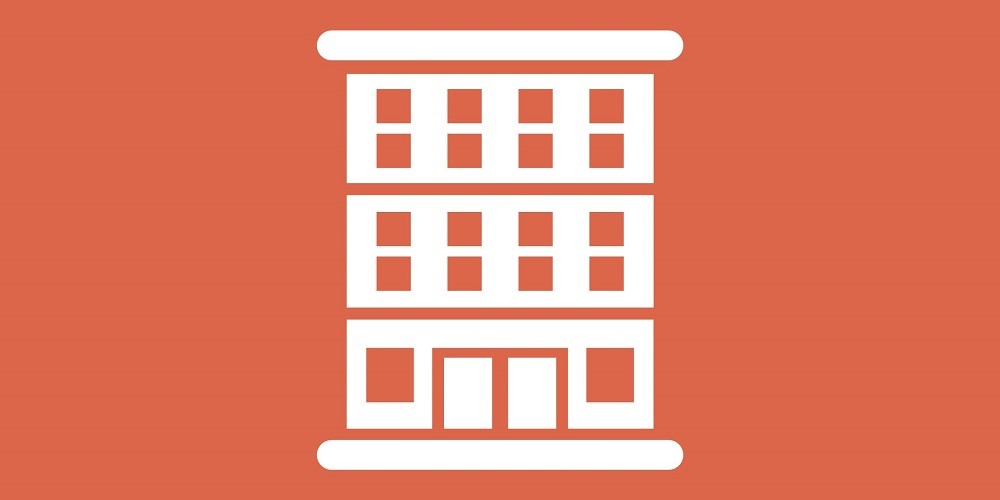Thématique | Affaires sociales et santé
Causes et effets de la financiarisation du système de santé
09 juillet 2025

Ecouter Le Pitch : un résumé audio du rapport !
Dans un contexte marqué par des évolutions profondes de l’offre de soins en France, des craintes se sont exprimées sur la « financiarisation du système de santé » et sur ses conséquences.
Par lettre en date du 17 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre délégué chargé des comptes publics, et le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention ont confié à l’Inspection générale des finances (IGF) et à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) une mission conjointe relative à la financiarisation du système de santé, sur un périmètre cantonné à l’offre de soins stricto sensu, excluant donc à la fois le secteur médico-social et les industries de la santé.
La période récente a été marquée par de profondes évolutions des caractéristiques et de l’organisation de l’offre de soins en France : tensions importantes sur les ressources humaines médicales et paramédicales qui devraient perdurer encore plusieurs années dans un contexte de vieillissement de la pyramide des âges de la plupart des professions de santé ; développement rapide du salariat médical ; aspirations d’une partie des jeunes générations aux formes d’exercice collectives ou en réseau, hyper spécialisation, innovations technologiques, etc.
Ces mutations, largement interdépendantes, ont généré dans le secteur privé et libéral un mouvement de regroupements et d’investissements, à l’origine d’importants besoins de financement auxquels ont répondu les acteurs traditionnels (les banques) mais aussi de nouveaux acteurs (fonds d’investissements et autres investisseurs privés, fonds de dette) attirés par les perspectives de croissance et de rentabilité du secteur, la solvabilisation publique de la dépense de santé, ainsi que les économies d’échelle et les gains d'efficacité potentiels. Entre 2020 et 2024, les fonds de capital‑investissement ont à eux seuls investi en fonds propres plus de 4 milliards d’euros. L’ampleur et la rapidité de ces transformations ont suscité des interrogations, voire des inquiétudes des autorités de régulation comme des professionnels de santé tant au regard du respect du principe déontologique d’indépendance que, plus généralement, de la préservation d’un haut niveau d'accessibilité et de qualité des soins.
Aussi la mission s’est-elle attachée, d’une part à décrire les modalités concrètes et les conséquences mesurables de ces phénomènes ; d’autre part à formuler des propositions visant à renforcer la capacité de la puissance publique à les réguler dans un sens conforme aux objectifs et priorités de la politique de santé, en prenant en compte l’hétérogénéité des situations.
Des interventions variées et un niveau d’endettement globalement préoccupant
Loin de répondre à un modèle uniforme, ces dynamiques structurelles de concentration et d’investissement, que les acteurs financiers sont venus accompagner, parfois susciter, le plus souvent accélérer, ont pris des formes très diverses, que ce soit pour le cadre juridique d’exercice (sociétés d’exercice libéral, centres de santé associatifs, sociétés de droit commun…) ou pour la structuration économique des groupes - témoignant de la capacité d’adaptation des investisseurs, professionnels comme non professionnels, aux contraintes réglementaires propres à chaque secteur. À cet égard, on peut constater que les secteurs qui ont mis en place les barrières juridiques les plus strictes à l'entrée d’investisseurs non exerçants, loin d’atteindre leur but de protection de l’indépendance des professionnels de santé ou de préservation de la qualité, n’ont fait que susciter des contournements, facteurs d'opacité et de dérives.
Qu’ils soient à l’initiative des fonds de capital‑investissement ou des professionnels eux-mêmes, ces mouvements de concentration et d’investissement ont en revanche en commun d’avoir entraîné un accroissement de l’endettement du secteur. Le niveau d’endettement atteint est aujourd’hui préoccupant, et pourrait, compte tenu des besoins d’investissement actuels et à venir, devenir critique en cas de tarissement des apports en fonds propres.
Des risques et des opportunités qui appellent une régulation renforcée
Pour répondre aux enjeux de la financiarisation, l’identification des effets qualitatifs de l’intervention des acteurs financiers sur l’offre de soins apparait comme l’enjeu prioritaire, mais cet impact demeure difficilement objectivable et pilotable en l’état des données disponibles. Même si certaines dérives ont été observées, ces données disponibles, ne permettent pas, en dehors de quelques exceptions notables, d’affirmer à date que les problèmes de qualité soient statistiquement plus importants dans les groupes financiarisés.
En analysant les données disponibles par secteur, l’Igas et l’IGF ont pu constater, d’une part, dans plusieurs d’entre eux, les effets positifs du mouvement de regroupement et d’apports de capitaux extérieurs sur l’efficience, le volume, l'accessibilité, ou la modernisation de l’offre de soins. D’autre part, les inspections ont mis en évidence des risques certes difficiles à quantifier mais dont certains indices laissent supposer qu’ils sont susceptibles de se concrétiser en cas de tensions sur les modèles économiques des acteurs.
Il importe donc d’éviter la concrétisation de ces risques mais aussi de parvenir à tirer pleinement avantage pour la collectivité de l’existence d’acteurs de grande taille. Pour favoriser l’indépendance des médecins, la qualité et l’accessibilité de l’offre de soins, et la maîtrise des coûts pour la collectivité, la mission propose d’activer cinq leviers :
- protéger l’indépendance des professionnels de santé par une clarification du cadre de gouvernance des sociétés d’exercice libéral, mais aussi plus largement par une modernisation du cadre déontologique ;
- mieux connaître les coûts réels des acteurs et améliorer la réactivité et la prévisibilité du système de tarification ;
- déployer un dispositif de suivi de la qualité en médecine de ville ;
- développer des approches contractuelles avec les groupes afin notamment de tirer parti de leur couverture multisites et de leurs capacités d’investissement ;
- prendre en compte l’existence d’acteurs portant un risque systémique local ou national, et mettre en place les dispositifs de prévention adéquats.
Soigner n’est pas une activité comme une autre : l’investissement privé ne doit pouvoir s’y déployer qu’en contribuant à l’amélioration durable de la qualité et de l’accessibilité des soins, dans le respect de l’indépendance d’exercice des professionnels. C’est pour le régulateur un défi nouveau, qui suppose une évolution du système réglementaire et tarifaire, notamment vers plus de transparence, de réactivité et de prévisibilité.
Page 24 sur 42
-
Évaluation du prêt à taux zéro (PTZ)
18 octobre 2019
Une mission IGF-CGEDD a été chargée d’évaluer le dispositif de prêt à taux zéro (PTZ) au regard de son objectif de primo-accession à la propriété des publics modestes, afin d’apprécier notamment l’effet déclencheur du PTZ et son impact sur l’artificialisation des sols.
-
Évaluation économique de l’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée (ETCLD)
18 octobre 2019
Une expérimentation territoriale de lutte contre le chômage de longue durée (« ETCLD ») lancée par la loi du 29 février 2016 consiste à proposer à des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an un contrat à durée indéterminée avec un temps de travail choisi et une activité adaptée à leurs compétences.
-
L'aide médicale d’État : diagnostic et propositions
11 octobre 2019
Une mission IGF-IGAS a été chargée d’évaluer les dispositifs de l’aide médicale d’État (AME) et des soins urgents et vitaux afin d’envisager une possible évolution de ces deux dispositifs, ayant notamment pour perspectives la maîtrise de la dépense publique et une plus grande convergence européenne des pratiques. Le travail d’analyse de données et de revue des processus conduit par la mission a abouti à la formulation de quatorze propositions qui portent sur la sécurisation du dispositif, pour limiter la fraude et les usages abusifs, et sur son amélioration, pour garantir un accès plus précoce aux soins et maîtriser les coûts de gestion.
-
Green Budgeting : proposition de méthode pour une budgétisation environnementale
28 septembre 2019
Une mission IGF-CGEDD a été chargée de recenser, au sein du budget de l’État, les dépenses et les recettes ayant un impact environnemental significatif, positif ou négatif, dans le but, ensuite, d’en évaluer précisément les effets.
-
Pour une chaîne logistique plus compétitive au service des entreprises et du développement durable
16 septembre 2019
La mission s’est concentrée sur la compétitivité des chaînes logistiques françaises, dans un contexte international de concurrence avec nos voisins européens.
-
La diversification des sources de financement du secteur du logement locatif social
12 juillet 2019
Une mission IGF-CGEDD a été chargée d’étudier l’opportunité et les conditions d’une diversification des modes de financement du logement social.
-
Evaluation du modèle économique du Grand Paris Express en phase d'exploitation
14 juin 2019
La mission visait à éclairer les deux « angles morts » du projet Grand Paris Express mis en lumière par le rapport de M. Gilles Carrez sur les ressources de la Société du Grand Paris (SGP).
-
Mission d’évaluation sur les relations entre les fondations abritantes et les fondations abritées
24 mai 2019
La loi permet à certaines fondations reconnues d’utilité publique d’abriter en leur sein des fondations qui ne bénéficient pas de la personnalité morale, ce qui permet de concilier la protection de la dénomination de la fondation et une meilleure reconnaissance des donateurs qui font des dons importants.
Page 24 sur 42
.svg)